 balades en france
balades en france
Le tourisme fluvial est en pleine croissance

sur le canal du Midi
6 700 kilomètres et 4 000 ouvrages d’art
Initialement dédiés au transport de marchandises, les canaux, rivières, fleuves sont de plus en plus appréciés comme des espaces de détente et de loisirs. Face à ce constat, on s’aperçoit que le tourisme fluvial qui désigne la navigation de plaisance, croisières et promenades à bord de bateaux à moteur, privés ou de location, connaît un véritable essor. Sachez également que dans l’appellation « tourisme fluvial » on peut englober le nautisme de proximité (canotage, pêche en barque, canoë-kayak, aviron) ou de ski nautique, de pêche, de plongée, de randonnée pédestre ou à vélo, de camping dans, bien évidemment, l’environnement immédiat d’un cours d’eau dont l’influence est manifeste sur la pratique touristique.
Tout cela pour vous annoncer que le tourisme fluvial en France connaît une croissance de son activité qui réjouit VNF (Voies Navigable de France) en charge du réseau (entretien et exploitation) sur notre territoire qui avec 6 700 kilomètres et près de 4 000 ouvrages d’arts (écluses, barrages, pont-canaux) est de loin le premier réseau navigable d’Europe.
En effet, et à l’image des bons résultats de l’activité touristique dans notre pays en 2018, 11,3 millions de passagers ont été embarqués en 2018 (+ 2% par rapport à 2017) ce qui permet à ce secteur de reprendre des couleurs après les difficultés rencontrées en 2016 (crues et attentats).
 La Seine et le Rhin « leaders »
La Seine et le Rhin « leaders »
L’Ile-de-France avec les croisières sur la Seine à Paris assurées par de nombreuses compagnies de bateaux touristiques dont la plus connue est la Compagnie des Bateaux Mouches connaît une dynamique sans précédent et représente 71 % de l’activité de cette filière.
Tout juste derrière cette région, fort est de constater que les croisières sur le Rhin font un véritable bon en avant puisque ce fleuve a transporté 48 % des passagers ayant profité d’une croisière fluviale dans notre pays, soit 221 900 personnes pour être précis. D’ailleurs, pas moins de 133 bateaux ont fait escale à Strasbourg.

La location des bateaux habitables séduit de plus en plus
Le tourisme fluvial est composé de quatre filières principales : les croisières fluviales (produits clés en main pour découvrir un territoire ainsi que toutes les spécialités culturelles et gastronomiques, mais également historiques) à bord d’un paquebot fluvial de 50 à 130 personnes ou une péniche-hôtel pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes), les bateaux-promenade (pour des croisières de quelques heures), la location de bateaux habitables qui est un bateau de moins de 15 mètres équipé de couchages que l’on peut louer sans permis et la plaisance privée dont les bateaux appartiennent aux particuliers.
Parmi ces quatre filiales, la location des bateaux habitables prend de plus en plus d’ampleur et dans ce secteur la région Occitanie arrive en tête. Il est vrai que le canal du Midi, qui relie Toulouse à la mer Méditerranée, offre une telle variété durant les 241 kilomètres de son parcours que nombreux sont les touristes à emprunter le canal. Malgré la fermeture de ce dernier mi-octobre 2018 suite aux inondations dans l’Aude, près de 10 % de contrats ont été vendus en plus.

près de Pont a Bar et La Cassine
L’électrique un axe de développement
Même si tous les clignotants sont « au vert » pour le tourisme fluvial, du côté de VNF on est conscient que des destinations touristiques restent encore sous exploitées en matière de tourisme fluvial comme le canal latéral de la Garonne, la Saône en amont de Lyon, le canal du Rhône. Voilà autant d’axes que VNF va s’attacher à développer tout comme les croisières fluviales en bateau habitable à propulsion électrique… sans permis.
Dominique Roudy
Photos VNF-D.-Gauducheau

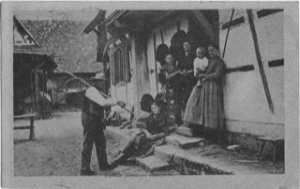 Il était une fois dans un petit village …
Il était une fois dans un petit village … A la recherche du Père Noël …
A la recherche du Père Noël … Jeux de Vins, jeux de Malins
Jeux de Vins, jeux de Malins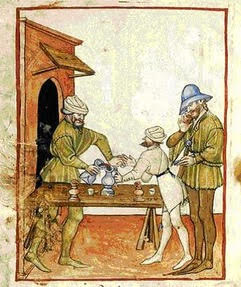 Pour retrouver une préparation se rapprochant de celle que l’on consomme il faut attendre le Moyen-âge. Au XIII° siècle, la ville de Montpellier est réputée pour la préparation de vins épicés et son commerce.Ville portuaire, les épices arrivaient d’Orient et notamment l’épice reine des vins épicés : le clou de girofle. Ce vin chaud plus sucré était aussi appelé « Hypocras ». Par la suite, de nouveaux ingrédients se sont ajoutés comme la cannelle, la cardamome ou les agrumes, découverts lors des grandes explorations. Puis la mode envahit progressivement l’Europe et notamment les cours des rois scandinaves. Grand amateur, le roi de Suède Gustave 1er développe la tradition du vin chaud dans son pays. A partir du 17e siècle, cette boisson aristocratique devint populaire et prit le nom de Glögg (vin chauffé) et l’engouement fut tel que le roi de Suède tenta de mettre un frein à sa consommation. Mais la mode était lancée et se répandit aux pays germaniques et à l’Europe centrale, là où il fait plus froid en quelque sorte.
Pour retrouver une préparation se rapprochant de celle que l’on consomme il faut attendre le Moyen-âge. Au XIII° siècle, la ville de Montpellier est réputée pour la préparation de vins épicés et son commerce.Ville portuaire, les épices arrivaient d’Orient et notamment l’épice reine des vins épicés : le clou de girofle. Ce vin chaud plus sucré était aussi appelé « Hypocras ». Par la suite, de nouveaux ingrédients se sont ajoutés comme la cannelle, la cardamome ou les agrumes, découverts lors des grandes explorations. Puis la mode envahit progressivement l’Europe et notamment les cours des rois scandinaves. Grand amateur, le roi de Suède Gustave 1er développe la tradition du vin chaud dans son pays. A partir du 17e siècle, cette boisson aristocratique devint populaire et prit le nom de Glögg (vin chauffé) et l’engouement fut tel que le roi de Suède tenta de mettre un frein à sa consommation. Mais la mode était lancée et se répandit aux pays germaniques et à l’Europe centrale, là où il fait plus froid en quelque sorte.
 Recette de la Pompe à l’Huile
Recette de la Pompe à l’Huile
 Entre architecture et costume traditionnel
Entre architecture et costume traditionnel

 Il y a plusieurs sortes de voyages.
Il y a plusieurs sortes de voyages.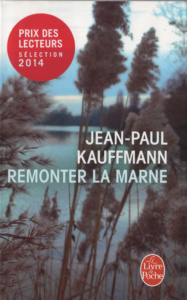

 La « pure » race bazadaise, la Grise, a failli disparaître. Native de Bazas en Sud Gironde, aux confins des Landes, cette race rustique a essaimé dans d’autres lieux au-delà de son berceau d’origine, quelques départements voisins des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie l’ont plébiscitée.
La « pure » race bazadaise, la Grise, a failli disparaître. Native de Bazas en Sud Gironde, aux confins des Landes, cette race rustique a essaimé dans d’autres lieux au-delà de son berceau d’origine, quelques départements voisins des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie l’ont plébiscitée.
 La Grise ? Pelage d’un joli gris «bonne sœur», yeux en amande entourés de blanc nacré. Elle a fière allure.
La Grise ? Pelage d’un joli gris «bonne sœur», yeux en amande entourés de blanc nacré. Elle a fière allure. La jeune «start-up» créée en novembre 2017 à la Ferme du Grand Peyrat à quelques jets de billes du bourg de Bazas est locataire de cette ferme. Immenses prairies nourricières où pendant quelques années les 41 Pure Grise broutent l’herbe, sauvegarde la beauté des paysages girondins, font perdurer le bocage. Depuis des millénaires, elles respirent ce paysage culturel et ses pratiques pastorales.
La jeune «start-up» créée en novembre 2017 à la Ferme du Grand Peyrat à quelques jets de billes du bourg de Bazas est locataire de cette ferme. Immenses prairies nourricières où pendant quelques années les 41 Pure Grise broutent l’herbe, sauvegarde la beauté des paysages girondins, font perdurer le bocage. Depuis des millénaires, elles respirent ce paysage culturel et ses pratiques pastorales.


 Bazas, un étonnant patrimoine
Bazas, un étonnant patrimoine